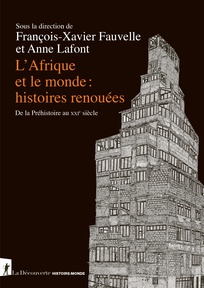
Par Erika Nimis et Marian Nur Goni, dans « L’Afrique et le monde : histoires renouées. De la Préhistoire au XXème siècle », sous la direction de François-Xavier Fauvelle et Anne Lafont. Editions La Découverte (2022, 456 pages)
« Quelle histoire de l’art en Afrique » se demande le curateur ougandais Serubiri Moses. La question, sous-jacente, est non seulement celle de la conservation des objets, mais aussi celle de l’autorité de l’expertise autour de ces objets comme l’indiquent justement les auteures à la suite du cinéaste ghanéen Nii Kwate Owoo. Aujourd’hui, les histoires de l’art en Afrique viennent principalement du Nord. D’où l’enjeu, pour ouvrir d’autres interprétations, de créer des fonds documentaires et des espaces de recherche sur le continent africain. C’est l’un des objectifs du Center Fort Contemporary Art de Lagos fondé en 2007 par l’historienne et curatrice Bisi Silva (1962 – 2019), doté d’une importante bibliothèque.
Cette même volonté de garder la maîtrise du récit par la conservation des sources, en l’occurrence les images, anime notamment l’installation vidéo « Gardiennes d’images » dédiée au photographe algérois Mohammed Kouaci, décédé en 1996 et dont les œuvres se retrouvent partout dans l’Algérie post-indépendance. Installation créée en 2010 par Zineb Sedira et Amina Menia.
En tout état de cause, l’historiographie de la photographie africaine se confronte au défi du caractère lacunaire de la documentation disponible. Les chantiers de sauvegarde numérique existent, tout en posant des questions éthiques sur les modalités d’accès, les droits des photographes mais aussi des personnes photographiées, en particulier dans un contexte non consenti. L’historien John Peffer plaide ainsi pour « une nouvelle éthique dans la manière de regarder et d’écrire à propos de ces images ».
La recherche dans le monde anglo-saxon sur les pratiques photographiques non occidentales, particulièrement sur le continent africain, figure à la pointe depuis la fin des années 1980. Elle met en évidence des « pratiques réappropriées, intégrées à des techniques de représentation préexistantes », mettant en évidence des trajectoires originales de photographes tels les Lutterodt opérant dans le dernier tiers du XIXème siècle à Accra et Freetown. Force est de constater que les recherches sont essentiellement promues depuis le Nord (à l’exception de l’université de Western Cape en Afrique du Nord), « notamment pas le marché de l’art ou le monde des musées qui en ont écrit une histoire partielle et partiale, mais qui fait autorité ».
Lors de ce qui est aujourd’hui désigné comme l’âge d’or des studios dans la seconde moitié du Xxème siècle, l’affichage d’autoportraits est largement répandu, pour rassurer une clientèle venue confier son image à un ou une professionnelle. Parallèlement aux photographies administratives, le portrait et l’autoportrait sont donc des sujets récurrents de la photographie africaines, qui d’une certaine façon alimentent encore l’oeuvre d’artistes contemporains comme Samuel Fosso et Zanele Muholi.
Les auteures examinent en suite l’oeuvre de deux hommes de la même génération, qui ont eu 20 ans alors que leur pays était sur la voie des indépendances. L’un au Mali, Félix Diallo (1931-1997) qui fut le premier photographe commercial de sa communauté, l’autre en Ouganda, Kadu Wasswa (né en 1933) qui a documenté ses activité tout au long de sa vie.
La photographie joue aussi un rôle important dans la réappropriation d’une histoire confisquée, dans l’Afrique du Sud post-apartheid. Le travail du photographe Santu Mokofeng (1956-2020) est à cet égard exemplaire, donnant à voir des photographies de familles noires sud africaines à la fin du 19ème siècle et dans la première moitié du 20ème siècle. Des familles qui possédaient des biens et nourrissaient des rêves de vie meilleures ; des photos toutefois oubliées des descendants de ces familles ; posant ainsi autant la question des représentations à l’époque des prises photographiques que celle des mémoires.
Les photographies dites anthropologiques forment un autre corpus du genre photographique. Une discipline qui s’est institutionnalisée dans les années 1930, et jusqu’alors mise en œuvre par les administrateurs, médecins, militaires, missionnaires présents dans les colonies. Un travail qui a parfois connu des vies non linéaires comme le recours à ces images par la diaspora somalie, à la suite des destructions massives d’archives lors de la guerre civile au début des années 1990, en vue de contribuer à reconstituer l’histoire du pays.
L’histoire de la photographie de presse reste par ailleurs à écrire. Elle constitue une source documentaire importante. Au Nigéria, on relèvera le travail de Peter Obe (1929-2013), notamment son livre « Nigéria. Adecade of crisis in Pictures » (1971) retraçant en image la guerre du Biaffra, mais aussi le blog de Ben Krewinkel « Africa in the Photobook », permettant de « tracer le jalon d’une histoire africaine de la photographie du continent » :
http://www.benkrewinkel.nl/
ou bien le « Nigéria Nostalgia Project », qui permet de collecter un gigantesque fonds documentaire.
Un aspect très intéressant du médium photographique est la façon dont il a été utilisé par certains pouvoirs politique africains pour asseoir leur légitimité. Cas exemplaire de cette politique de communication visuelle, le sultan Njoya de Foumban dans l’actuel Cameroun, qui sut utiliser la mise en scène photographique de son pouvoir vis à vis des puissances coloniales. Plus proche, on peut citer l’Agence nationale d’information malienne au début des années 1960 dans son œuvre de de communication et de propagande au service de l’édification de la nation selon un modèle socialiste.
De nos jours, les artistes et photographes africains et de la diaspora rayonnent sur la scène internationale comme en Afrique, où les biennales d’art et de photographie se sont développées. Les diasporas jouent un rôle actif, contribuant à rendre plus complexe l’histoire de la photographie sur le continent et participant à sa désessentialisation. Exemple de ces trajectoires plurielles, le travail du kenyan Priya Ramrakha (1935-1968), tué alors qu’il couvrait la guerre du Biaffra, photographe aussi entre autres du mouvement des droits civiques aux Etats-Unis, et finalement incarnation en quelque sorte de cette dimension panafricaine.
In fine ce texte met ainsi à mettre en évidence « une diversité d’histoires africaines, transnationales et connectées des pratiques photographiques sur le continent, en montrant en outre que les connexions entre l’Afrique et les continents européen et américain, longtemps privilégiés dans ce champ d’étude, ne constituent plus que l’un des axes possibles à partir desquels écrire ces histoires.
Soyez le premier à commenter